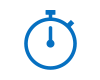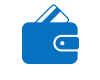Entretien avec Agnès Blocher – S’ouvrir à l’espérance : Cheminer vers la guérison après le traumatisme de l’abus sexuel
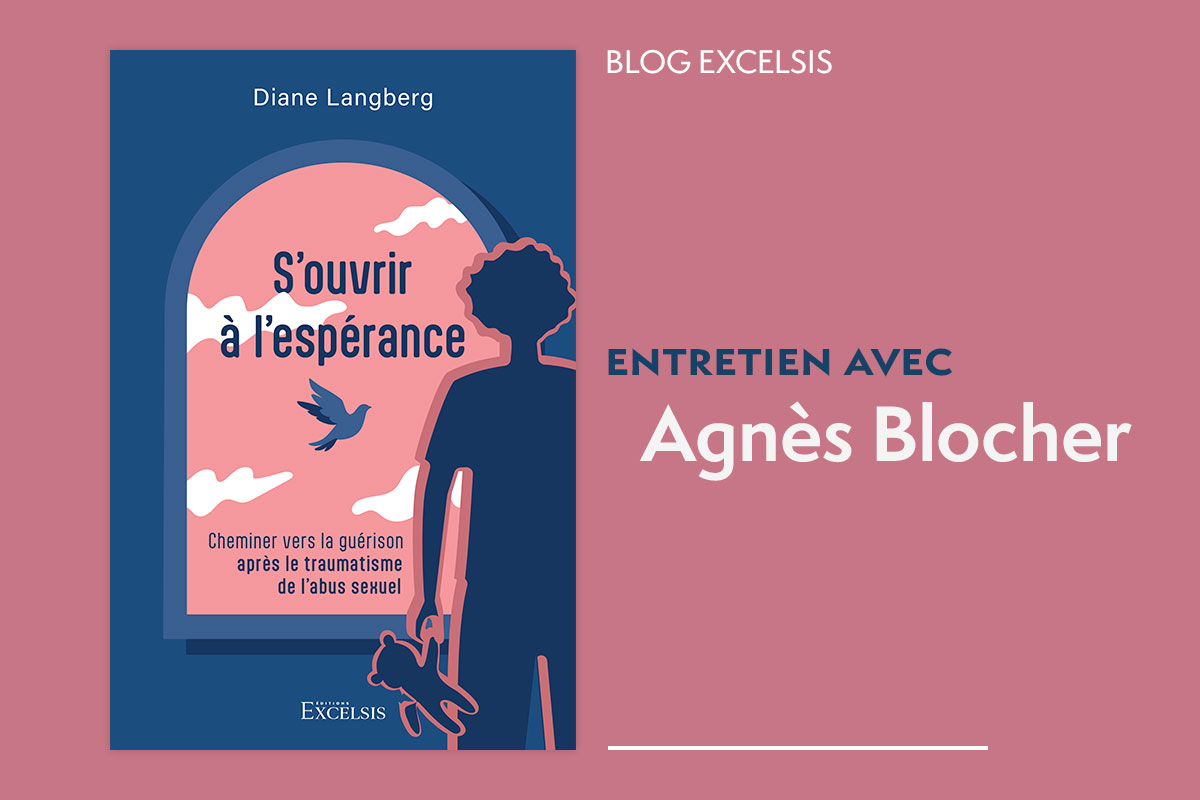

- Virginie Lutete
- 16 Avril 2025
1. Pouvez-vous vous présenter ?
Pharmacienne de formation initiale, j’ai opté pour une réorientation professionnelle après 15 années en pharmacie d’officine. En 1999, j’ai obtenu mon Master en psychologie clinique et psychopathologique, puis j’ai exercé 25 ans en Protection de l’Enfance, dans le cadre d’une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS). Comme psychologue institutionnelle, j’ai travaillé auprès d’enfants et d’adolescents ayant subi des maltraitances intra-familiales le plus souvent graves, pour lesquels les Juges des enfants ordonnaient des mesures de protection. Le placement en MECS en est une.
Parallèlement à cette activité séculière, j’ai donné pendant une dizaine d’années des cours sur le développement de la personne et sur la psychologie des groupes auprès des étudiants de l’Institut Biblique de Nogent, et j’ai assuré, dans le contexte de leurs études, un accompagnement thérapeutique individuel auprès de ceux et celles qui le désiraient.
Actuellement, je ne travaille plus en tant que psychologue salariée mais je continue une activité libérale.
Je garde toujours à cœur la protection des enfants, et en particulier celle des enfants dans les Églises de professants. En effet, l’Église se doit d’être un lieu de sécurité et de protection pour les plus vulnérables, et nous devons être attentifs et formés au repérage des différentes formes de violences auxquelles les enfants sont susceptibles d’être exposés jusque dans les familles chrétiennes.
2. Qu’est-ce qu’un abus sexuel ?
Sur le plan légal, en France, on parle en termes de violences, d’agressions ou d’atteintes sexuelles. Le terme d’abus sexuel est réservé au langage courant, et il est à manier avec précaution quand les victimes sont mineures. En effet, un abus sexuel sous-entendrait qu’il existe une manière non abusive d’imposer une sexualité adulte à un enfant, ce qui entretient la confusion. Rappelons que la majorité sexuelle en France est fixée à 15 ans.
L’article 222-22 du code pénal définit l’agression sexuelle comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.
L’article 222-23 du code pénal, quant à lui, définit le viol comme étant Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
La loi a évolué en ce qui concerne les mineurs autour de la notion de consentement. Les juges n’ont plus à établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l’agression sexuelle. La question du consentement de l’enfant ne se pose donc plus en-dessous de l’âge de 15 ans et de 18 ans dans les cas d’inceste. Les violences sexuelles sont qualifiées d’incestueuses lorsque l’agresseur est un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce. Il en est de même du conjoint ou concubin en cas de famille recomposée, si ce dernier a une autorité de droit ou de fait sur la victime.
Aux yeux de la loi française, les agressions sexuelles sont des délits et les viols des crimes. Ils sont lourdement sanctionnés en particulier quand les victimes sont mineures :
- le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans est puni de 20 ans de réclusion criminelle ;
- le crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans) de 20 ans de réclusion criminelle ;
- le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende ;
- le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur (de moins de 18 ans) de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende.
3. Quel est son impact sur la victime ?
Dans son livre S’ouvrir à l’espérance, Diane Langberg explore de manière très précise, documentée et humaine, les conséquences de l’abus sexuel sur l’ensemble de la personnalité. Elle donne également des pistes à la fois réalistes et encourageantes aux survivants, comme elle les nomme très justement, pour vivre et non plus seulement survivre.
L’impact de l’abus sexuel sur la victime est multiple. Il touche tous les secteurs de la personnalité, à court terme mais également à distance de l’acte transgressif. C’est un véritable traumatisme. Plus la victime est jeune et plus elle est dépendante de son agresseur (liens familiaux notamment), plus les répercussions de l’agression sexuelle subie impactent négativement son développement. La victime présente le plus souvent un syndrome post traumatique.
Sur le plan physique, le rapport au corps est perturbé par des ressentis de dégoût, d’étrangeté, de désirs de se faire mal (scarifications, troubles de l’alimentation, rituels de propreté…), l’envie de le dissimuler ou son contraire, de l’exhiber.
Au niveau cognitif, la pensée est sidérée, désorganisée. Si la victime est jeune et si l’agresseur la menace, la réduit au silence ou lui fait croire que les actes sexuels qu’elle subit sont normaux, sa capacité de jugement s’en trouve pervertie : elle en vient à penser, pour survivre, que le mal est bien. La confusion qui règne dans son esprit retentit sur sa capacité à penser juste.
Au niveau affectif, la victime est débordée par des affects de peur, de colère, de honte, de culpabilité. Là encore, plus elle est jeune, plus elle est débordée par un déferlement émotionnel dont elle va chercher à se protéger par des mécanismes défensifs inconscients et coûteux sur le plan psychique : mise à distance des émotions, évitement, dissociation post traumatique, repli sur soi, tristesse, dépression, addictions, dépendances…
Au plan relationnel, il y a perte de confiance en soi et en l’autre. Si la victime est un enfant et que l’agresseur est un adulte tutélaire, la confiance et le sentiment de sécurité sont durement touchés, et l’estime de soi s’effondre. Il convient dès lors pour la victime de se protéger d’un monde extérieur vécu comme dangereux. Sa boussole relationnelle, faussée, peut lui faire inconsciemment rechercher les relations toxiques.
L’ouvrage de Diane Langberg décrit avec beaucoup de précision et de finesse l’ensemble de ces mécanismes à l’œuvre, tout en faisant preuve d’un profond respect envers les victimes. Elle montre notamment que les blessures affectives, relationnelles et cognitives consécutives à un abus sexuel, ont aussi des conséquences sur notre relation à Dieu. Comment lui faire confiance, comment comprendre pleinement sa grâce et s’y abandonner, quand l’affectivité est gelée, quand le manque de confiance préside aux relations et que la pensée est confuse ?
4. Que dit la Bible sur l’abus sexuel ?
La maltraitance sexuelle pervertit l’ordre créationnel voulu par Dieu, et cette perversion se trouve aggravée quand elle prend pour objet un enfant et/ou quand elle se produit à l’intérieur de la famille.
Diane Landberg prend comme illustration biblique le viol de Tamar par Amnon, son frère, triste épisode qui nous est raconté dans 2 Samuel 13.1-22. Dans ce texte d’un réalisme percutant, tout le déroulé du passage à l’acte incestueux est décrit : désir incestueux du frère encouragé par la ruse d’un ami, aveuglement du père (qui n’est autre que le roi David), rejet, déshonneur et affliction de Tamar après le viol subi, silence imposé par son frère Absalom, passivité de David, irrité sans pour autant faire justice. Cet engrenage pervers aboutit au meurtre d’Amnon par son frère Absalom.
Nous trouvons dans ce passage, par la bouche de Tamar, la condamnation d’un tel acte : « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n’agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux ! » (2 Samuel 13.12).
Comment penser que notre Dieu, le Dieu de la vie, pourrait cautionner de tels abus qui portent en eux le germe de la mort ?
5. Une guérison est-elle possible ? Comment ?
La guérison est une notion à manier avec prudence, discernement et un réalisme qui laisse la part à l’espérance.
Diane Langberg insiste sur le fait que la guérison est un cheminement qui peut prendre toute la vie. Le travail intérieur de reconstruction est un processus qui mobilise tout l’être et qui peut sembler insurmontable. Mais il est essentiel de s’ouvrir à l’espérance comme l’auteur le formule si bien, accompagné par notre Dieu. Jésus a connu la souffrance physique et morale quand il était sur terre, dans un corps semblable au nôtre. Il nous connaît, chacun et chacune, et sait que l’abus sexuel peut désorganiser tout l’être. Ce qui est si délétère, dans l’abus sexuel, ce sont ses conséquences relationnelles. La perte de confiance en l’autre induite par l’abus sexuel peut s’étendre à notre relation à Dieu et semer le doute : je ne ressens pas sa présence ; pourquoi ne m’a-t-il pas protégé(e) ?; est-ce que je peux encore lui faire confiance ?
C’est pourquoi Diane Langberg encourage les survivants à ne pas rester seuls avec leur désarroi et leur souffrance. Il est nécessaire d’être accompagné et soutenu par des personnes de confiance dans ce cheminement vers la restauration : professionnels formés et frères et sœurs en Christ sont les deux directions qui sont données par l’auteure pour sortir du silence-prison qui enferme, nommer ce qui a été subi, faire face aux affects qui débordent et réapprendre à vivre. Mais ce n’est pas magique, la guérison complète, comme c’est parfois le cas dans les maladies physiques, n’interviendra peut-être pas au cours de cette vie terrestre, mais cette certitude demeure : un jour, auprès de Dieu, nous serons guéris et nous goûterons à la vie dans toute sa plénitude.
6. Où, quand, comment chercher et trouver de l’aide ?
La démarche de chercher de l’aide n’est pas un allant de soi pour le survivant d’un abus sexuel. Pourquoi ? Parce que le sentiment de honte, la culpabilité, le manque d’estime de soi et la peur de ne pas être cru et d’être rejeté doivent d’abord être surmontés. La souffrance d’être, de vivre, sont souvent ce qui pousse la victime à chercher de l’aide. Le désir de vie l’emporte, heureusement !
Mais attention, mieux vaut ne pas se tromper d’adresse lorsque l’on a connu l’abus sexuel suivi parfois du désaveu. Diane Langberg donne des pistes pertinentes à la fois pour la victime désireuse d’être aidée, mais aussi pour ceux qui souhaiteront lui venir en aide : un(e) thérapeute formé(e) à l’accompagnement spécifique des personnes victimes de traumatismes ; des accompagnants chrétiens empathiques, formés eux-aussi, car les vœux pieux et les recettes spirituelles toutes faites font plus de mal que de bien dans ce contexte.
Si le courant ne passe pas, si l’on se sent jugé, mal écouté et mal compris, il ne faut pas hésiter à se tourner vers d’autres personnes avec lesquelles un sentiment de sécurité et de compréhension rassurera et aidera à cheminer. Comme son nom l’indique, l’accompagnant, thérapeute ou non, est là pour…accompagner, c’est-à-dire cheminer à côté et au rythme de la victime. Il ne s’agit pas de la pousser pour aller plus vite, ni de la dévier de son chemin pour un autre sentier qu’elle n’aurait pas choisi. Il s’agit d’être là, de trouver la bonne distance relationnelle, d’être patient, de l’aider à se relever si elle tombe, mais en aucun cas de la forcer. Le forçage, elle connaît, c’est ce qui l’a mise à terre.
7. Que faire si je suis témoin d’abus sexuel ?
Pour répondre à cette question, il est important de se référer au droit qui a cours en France. Car nous ne sommes pas, chrétiens, au-dessus des lois. Ne faisons pas comme David qui, en dépit de sa colère, n’a pas condamné le crime perpétré par son fils Amnon sur sa sœur Tamar. Informons-nous et fuyons la lâcheté, souvent déguisée en pseudo tolérance.
Le devoir de signalement apparaît comme un devoir légal et moral qui fait appel à la responsabilité de chacun, dans un contexte d’urgence, de danger ou de maltraitance en vue de la protection d’une personne. Ainsi, la loi française stipule qu’aussi bien la victime que le témoin d’un acte d’abus sexuel se trouvent dans le devoir de dénoncer l’acte auprès des autorités compétentes :
- la plateforme du gouvernement dédiée au signalement des violences sexuelles ;
- les autorités administratives : Président du Conseil Général du département où réside la personne à protéger ;
- les services sociaux du conseil général (Aide Sociale à l’Enfance) ;
- les services de police ou de gendarmerie,
- le procureur de la république ou son substitut au tribunal de Grande instance dont dépend le domicile de la personne à protéger ;
- le juge des enfants.
Pour la victime majeure ou mineure en situation de danger, il existe le code discret : c’est le fameux code masque 19 qui, en demandant à acheter un masque 19, permet d’alerter le pharmacien qui comprend rapidement que la personne qui se trouve en face de lui a besoin d’aide.
Ajoutons deux points importants :
- pour un témoin, la non-dénonciation de violences sexuelles sur mineur est considérée comme un délit par la loi. La peine encourue est de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
- Pour une victime ayant subi des violences sexuelles quand elle était mineure, il existe un délai de prescription pour déposer plainte : 20 ans après la majorité (38 ans) pour une agression sexuelle avec circonstance aggravante et jusqu’à 30 ans après la majorité (48 ans) en cas de viol ou de proxénétisme.
8. Avez-vous un mot d’encouragement pour nos lecteurs ?
Je laisse ce soin à Diane Langberg qui écrit avec tant de justesse ces mots : « Il y a un Rédempteur. Il est la Vérité, et la vérité vous rendra libres ».