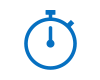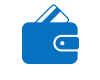Entretien avec Henri Blocher – La doctrine de l’Église et des sacrements
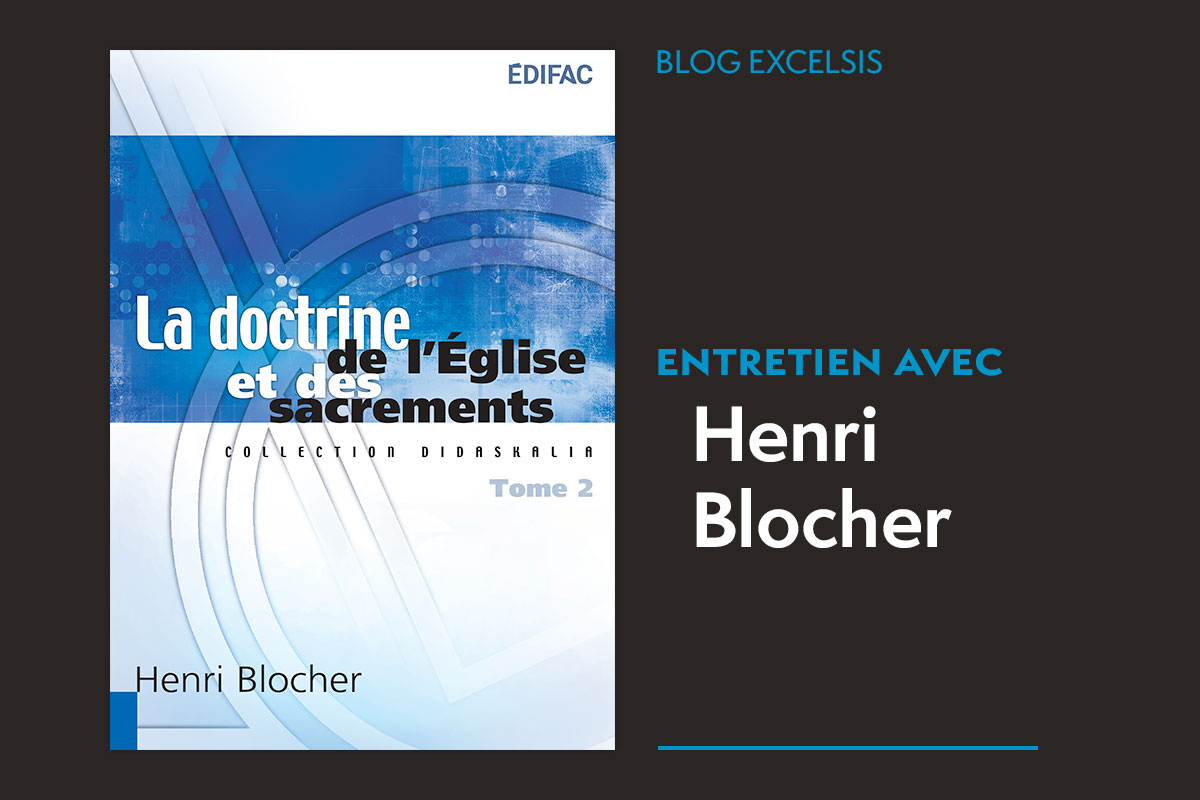

- Virginie Lutete
- 22 Mai 2024
1. Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Henri Blocher, j’ai été pratiquement toute ma vie professeur de matières bibliques et théologiques. J’ai commencé à enseigner à l’Institut biblique de Nogent en rentrant du service militaire prolongé que j’avais pu effectuer dans l’aumônerie protestante. J’ai commencé l’enseignement à temps partiel en parallèle de mes études supérieures. En 1965, quand la Faculté de théologie évangélique de Vaux-Sur-Seine a été fondée, c’est devenu pratiquement du plein-temps dans cette institution, et j’ai continué à y enseigner jusqu’à il y a peu. Ainsi, c’est principalement comme théologien que j’ai exercé mon ministère avec quand même une petite expérience pastorale, mais assez brève et légère. Autrement, l’implication dans la vie de mon Église m’a aussi donné une certaine expérience de terrain.
2. Qu’est-ce que l’ecclésiologie ?
L’ecclésiologie, c’est la doctrine de l’Église. Le suffixe logie signifie qu’on parle de sciences, il sert à construire leur nom (bio-logie ; science du vivant). La première partie du terme ecclésiologie indique l’objet de cette science : l’ecclésia, le mot grec qui a donné « église » par simple transcription, via le latin, en français. Le mot, il est important de le préciser, a un double arrière-plan. Dans le Nouveau Testament, il a d’une part son usage pour l’assemblée d’Israël lorsqu’elle est convoquée pour entendre la parole de Dieu et lui rendre le culte qui lui est agréable, et d’autre part, son emploi pour les assemblées politiques des cités grecques. L’assemblée des citoyens à Athènes s’appelle l’ecclésia et l’on retrouve ce terme utilisé de cette façon dans le livre des Actes (Actes 19.32). L’ecclésia c’est donc l’assemblée de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus comme leur Messie, et lui ont prêté allégeance comme à leur Seigneur. Cette assemblée, au sens le plus large, de tous les temps et de tous les lieux, est l’Église universelle. L’assemblée qui se réunit localement est une sorte de modèle réduit de cette assemblée de tous les temps et de tous les lieux.
3. Pourquoi avoir écrit un ouvrage en deux tomes sur cette doctrine ?
S’il y a deux volumes, c’est qu’un seul aurait été un peu trop gros ! En même temps, une dualité qui structure la doctrine rend logique la disposition en deux volumes. Le premier volume traite de la notion même de l’ecclésia de Jésus-Christ, il représente donc la théorie fondamentale. Parmi les actes de l’Église, l’histoire a spécialement mis en valeur deux actes symboliques : le baptême et ce que nous appelons souvent la Cène ou la sainte Cène (beaucoup disent « eucharistie » et le Nouveau Testament plutôt « repas du Seigneur »). La doctrine des sacrements joue un rôle très important dans le dialogue entre les diverses branches de la chrétienté et n’est pas un sujet sans importance dans la Bible, bien qu’il ne soit que de second rang. Il paraissait donc nécessaire de lui consacrer une place importante. En outre, j’ai rajouté, c’est aussi un sujet de grand débat, un chapitre, quelque peu un appendice (quand même environ soixante pages), sur les ministères dans l’Église. Plus précisément : le ministère qu’a l’Église dans le monde et les ministères, en son sein, qui lui permettent de l’accomplir.
4. Quels sont les fondements bibliques de l’Église ?
Quant aux fondements bibliques, la volonté de Dieu de se constituer un peuple vient d’abord, une humanité qui correspond à son intention pour l’être humain. Et Jésus lui-même a dit : « Je bâtirai mon Église » (Mt 16.18). C’est là le fondement tout à fait premier. Dieu a décidé de constituer une assemblée de tous ceux qu’il a choisis dès avant la fondation du monde pour hériter du salut, pour être unis à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Quant à la doctrine elle-même, elle se fonde sur ce que nous en dit la Parole de Dieu, à nous donnée pour notre instruction. Cela permet de discerner quels doivent être les contours des structures ecclésiales. La doctrine de l’Église veut exposer l’enseignement de l’Écriture sainte pour autant qu’elle se rapporte au sujet, et le sujet est présent très largement dans toute la Bible.
5. Pouvez-vous nous présenter les trois grandes conceptions de l’Église (catholique, réformée et professante) ?
Pour commencer, je précise que je ne restreins pas le qualificatif évangéliques – comme c’est la tendance dans les médias – aux seuls baptistes, mennonites, frères, pentecôtistes, etc. – que j’étiquette professants. Parmi les réformés et à commencer par Calvin, tous ceux qui sont respectueux de l’autorité biblique comme souveraine je les appelle évangéliques, et c’est l’usage ancien du mot. Je déplore que l’on réserve le qualificatif évangélique à ceux qui tiennent à la « tierce ecclésiologie », comme je l’appelle, qui est la mienne ; je ne veux surtout pas exclure de l’ensemble évangélique ceux qui appartiennent à la tradition réformée, plus directement celle de Calvin.
Ce point de détail sur l’usage des mots réglé, je plaide que la division triadique que vous venez d’évoquer correspond bien à la réalité des choses. Comme toujours, on peut, dans une très grande diversité, discerner un plus grand nombre de catégories. Il y a bien sûr des différences entre les héritiers de la Réforme et entre les divers professants. Le mot professant fait allusion à la profession de foi personnelle. Selon les professants, pour être membre d’une Église locale qui correspond à l’Église universelle, mais qui s’en distingue comme « locale », il faut professer personnellement la foi. C’est cela qui caractérise la « tierce » ou troisième ecclésiologie. Je souligne que la deuxième (réformée) et la troisième ecclésiologie ont beaucoup en commun.
À quoi correspond la répartition triadique ? Il y a trois réponses à la question principale. Celle-ci concerne ce qui est premier dans l’Église, et entièrement constitutif, et ses prérogatives. La première réponse est que l’Église est d’abord une institution, une structure majestueuse dotée de grands pouvoirs, et, seulement à titre second, une assemblée composée d’êtres humains croyants. La deuxième réponse garde une certaine priorité pour l’institution, mais seulement dans la dimension du visible, et comme faillible, « pauvrette Église » disait Calvin. Pour la troisième réponse, l’Église est d’abord le peuple de Dieu lui-même, rien d’autre que l’ensemble formé par les croyants. L’Église est la communauté de ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, et, ensuite, elle a des « institutions », des structures établies en son sein pour son développement et son bien-être.
Du côté catholique romain, c’est très clair : l’Église est d’abord une institution. Elle est la mère qui précède ses enfants et les enfante, notre Sainte Mère dont l’autorité s’impose. Elle revendique cette prérogative au titre de la continuation de l’œuvre du Christ et même de son être à la fois humain et divin. Le thème de « l’Incarnation continuée », bien que les théologiens aujourd’hui soient très prudents dans sa défense, continue d’être central dans l’ecclésiologie catholique. Et l’Incarnation se continue spécialement par le moyen des sacrements.
Du côté du protestantisme réformé, les choses sont beaucoup plus complexes, mais l’Église continue d’être conçue, l’Église visible – car il y a une dualité structurelle importante entre l’Église visible et l’Église invisible –, comme une institution. Faillible, elle a beaucoup, beaucoup, moins de pouvoir que dans le modèle catholique ; cependant, par la prédication et l’enseignement de la Parole, elle aussi enfante les croyants. Le thème de l’Église mère est présent chez Calvin. Il est intéressant de noter qu’il ne l’est pas (présent) au début de son ministère (sauf pour l’Église invisible selon Ga 4.26), mais l’évolution de sa théologie l’a conduit finalement à lui faire place. La précédence de l’institution fait que les croyants ne sont pas les seuls membres légitimes de l’Église visible. D’après les définitions, leurs enfants le sont aussi, sans nécessairement professer la foi – et c’est ce qui a engendré ou favorisé le phénomène historique de l’Église « de multitude ».
Quant aux professants, ils commencent par le peuple des croyants, engendrés par la Parole à laquelle l’Esprit donne son efficacité régénératrice. C’est ainsi que se constitue l’Église avant qu’elle reçoive des institutions de la part du Seigneur, les ministères en particulier. Voilà la grande triplicité ecclésiologique qui marque le christianisme, comme on l’appelle.
6. Qu’est-ce que qu’un sacrement ?
En ce qui concerne le mot sacrement il me faut à nouveau faire un petit commentaire sur le vocabulaire. À mon avis, il est finalement plus simple de retenir le terme, en faisant ressortir les divergences de vue sur la nature et la fonction des sacrements ; mais certains, parmi les professants essentiellement, sont réticents : ils ont peur que si on emploie le mot sacrement, la conception catholique du sacrement va s’infiltrer inexorablement. Je ne le crois pas. On peut utiliser le mot en associant une notion, une explication, différente – ce choix n’est pas celui de tous.
Le premier usage probable, (non pas tout à fait certain), se trouve dès le début du deuxième siècle. Il n’est pas dans le Nouveau Testament, écrit en grec et non pas en latin, car sacramentum est de la langue des Romains. Il apparaît pour la première fois, dans son application à des pratiques chrétiennes, dans une lettre du gouverneur de Bithynie, Pline le Jeune, à son empereur. Il lui demande ce qu’il faut faire des chrétiens. Il en a torturé quelques-uns pour avoir les renseignements, et il dit : « Mais apparemment, ils prétendent ne rien faire de grave, et ils se sont engagés par sacramentum à avoir une conduite conforme au Bien, à l’honnêteté, etc. » Nombre de commentateurs pensent qu’il s’agit du baptême comme engagement à suivre la voie du Christ. Sacramentum servait pour le serment de l’engagement militaire, d’allégeance à l’empereur. La racine, évidemment, évoque le sacré : l’engagement du soldat romain était considéré comme tel. Le mot sacramentum dans ce sens a donné le mot « serment » en français : Pline semble l’employer à peu près dans ce sens pour le baptême. Cependant, il évoque aussi le sacré, et cette composante a facilité un glissement de sens. Surtout à partir du troisième siècle, il se charge de connotations étrangères aux données bibliques, et fait penser à des cérémonies mystérieuses, des cérémonies où le sacré intervient. Les Grecs dans le monde méditerranéen appelaient « mystères » de tels rites, surtout dans ce qu’on nomme les « religions à mystères ». Les chrétiens, d’abord réticents, se sont mis à parler du baptême et de la Cène comme de leurs « mystères ». Le motsacramentum a servi à traduire mystère quand on s’est mis à parler latin en Occident dans les Églises et en théologie (assez longtemps les chrétiens de Rome ont parlé grec). Peu à peu, s’est greffée l’idée que quelque chose se passe, de mystérieux, une efficacité spirituelle dans l’acte matériel. Ainsi s’est constituée la notion catholique du sacrement, d’une manière très progressive, mais toujours enseignée dans le catholicisme romain (des théologiens de renom, aujourd’hui, remettent pourtant en cause le « dogme » selon lequel le sacrement, par le simple fait qu’il est administré, confère la grâce qu’il représente).
Dans la théologie de la Réforme, qu’on appelle magistérielle parce qu’elle s’est implantée à l’aide des magistrats (les rois, ducs, conseils de villes, etc.), les luthériens ont gardé une bonne dose de cette idée que le sacrement cause la grâce qu’il représente. Luther tenait une position très complexe : attaché à la puissance causative du baptême, il mettait aussi en valeur que l’action dans le sacrement est le fait de la Parole. Du côté de la théologie réformée, celle dont Zwingli est le premier initiateur, mais ensuite Calvin, le plus grand acteur, cette notion a été abandonnée et le sacrement est censé produire les effets qu’on peut souhaiter en tant que parole visible, comme une forme de la prédication. La prédication enfante les êtres humains pour le royaume de Dieu, le baptême et la Cène sont une prédication visuelle : c’est ainsi qu’ils sont efficaces.
La doctrine des sacrements qui correspond à l’ecclésiologie professante, reconnaît cette fonction de parole visible à la prédication et à la participation à la Cène. Mais le trait spécifique du sacrement est l’engagement qu’il exprime, la réponse à la grâce de Dieu, la réponse à la prédication. La Première épître de Pierre (3.21) formule ce qui ressemble le plus à une définition du baptême dans le Nouveau Testament : l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu ; la conscience a été purifiée par la Parole de Dieu, par la grâce, et s’engage envers Dieu. Comme l’engagement a la forme de la confession de foi – je crois et je redis, comme la vérité à laquelle j’adhère de tout cœur, ce que la Parole m’a dit –, la Parole retentit à nouveau, et elle engendre une édification dans la grâce. On retrouve ainsi le rôle, le bienfait, que les réformés mettent au premier rang. Pour la Cène, elle est « parole visible », mais ce qui spécifie le rôle de sacrement est ceci : c’est une prédication dont les membres de l’Église ne sont pas d’abord, les auditeurs, mais les prédicateurs ! « Chaque fois que vous faites ces choses, vous annoncez la mort du Seigneur ; [vous tous] » (1 Co 11.26). Ainsi se disposent et se déploient les trois grandes théologies des sacrements.
7. Qu’est-ce que le ministère de l’Église dans le monde ?
En ce qui concerne le ministère de l’Église dans le monde, on peut commodément reprendre la double image donnée par Jésus : vous êtes la lumière du monde, et vous êtes le sel de la terre. À l’Église échoit une double mission. D’une part faire briller la lumière de l’Évangile. On parle de la mission au sens un peu restreint : mission « d’évangéliser », de faire connaître l’œuvre de Dieu en Jésus-Christ, et la possibilité d’être sauvés pour cette vie et pour l’âge qui vient par la foi en Jésus. D’autre part : « vous êtes le sel de la terre ». Le sel prévient et freine la corruption, la pourriture des aliments. C’est le grand préservateur dans la culture de l’époque (il n’y avait pas de congélateur !). Être le sel de la terre, c’est être dans le monde et par toute action qu’on peut mener, par la conduite qu’on peut tenir, freiner la corruption – et permettre ainsi à l’histoire de continuer. Cette mission de « sel » a des dimensions interpersonnelles très privées, mais aussi des dimensions sociopolitiques. Je pense qu’elle est seconde par rapport à la première, mais elle n’est pas non plus à écarter, à ignorer. La dualité caractérise le ministère de l’Église.
8. Quels sont les différents ministères et comment sont-ils présentés dans la Bible ?
Dans l’Église telle que voulue par Dieu, celui-ci donne des capacités à certaines personnes pour remplir des services qu’on appelle « ministères ». Il y a deux grandes sortes de ministères comme nous pouvons bien le distinguer dans la Première épître de Pierre (4.11) : d’un côté, les ministères de la Parole : la prédication de la Parole parce que c’est le moyen de grâce choisi par Dieu pour sauver les humains et nous édifier dans la vie nouvelle ; de l’autre, les ministères de la charité fraternelle envers tous, c’est-à-dire les services de secours et d’assistance. Ces derniers s’exercent au bénéfice de tous, et spécialement des frères et sœurs dans la foi (Ga 6.10). Une polarité marque aussi les ministères de la Parole : enseignement et prophétie. Comme la Parole doit régir la vie de la communauté, au ministère de la Parole s’associent, en restant distinctes, les tâches pastorales (le berger conduit le troupeau), les « pilotages » (on peut ainsi traduire en 1 Corinthiens 12.28) : elles sont assignées aux anciens, assistés des diacres.
Le Christ n’a pas besoin d’un « Vicaire » sur la terre, au sommet d’une hiérarchie : il est activement présent par son Esprit. Dans sa grâce, il veut bien se servir des instruments que nous sommes, tellement inadéquats en nous-mêmes, pour bâtir, lui, son Église.